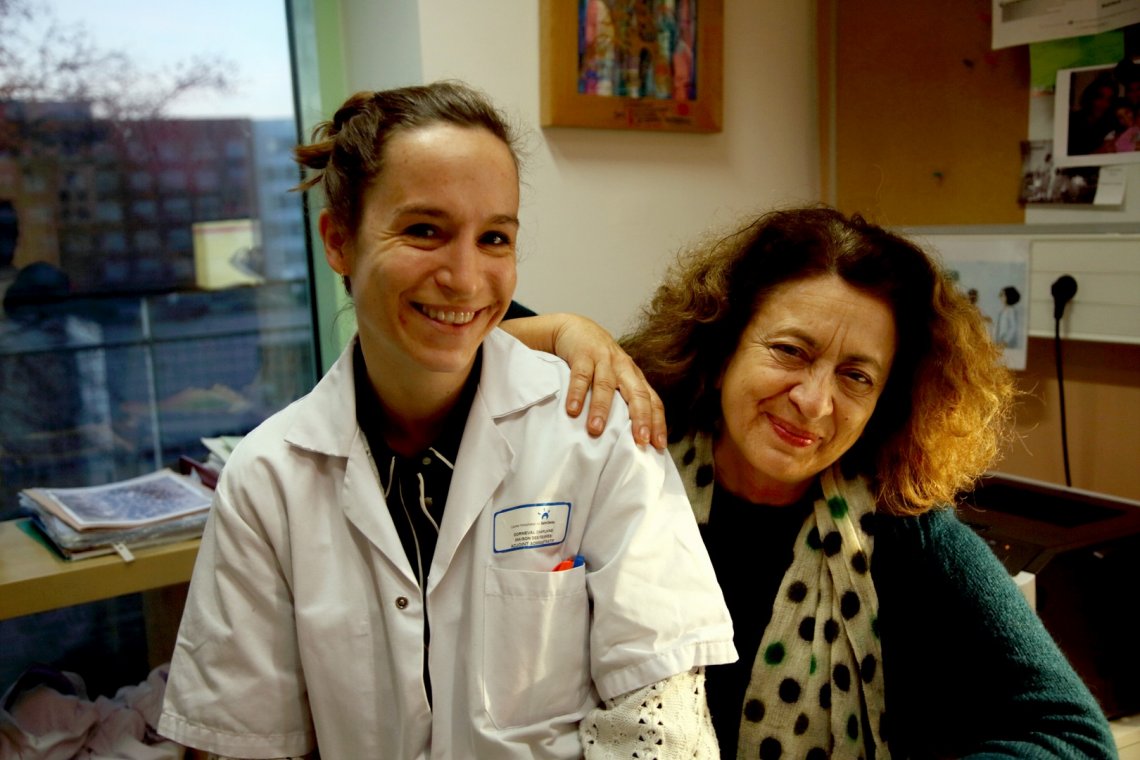La Maison des femmes, à Saint-Denis (93), est l'un des seuls lieux en France à regrouper au sein d’une même enceinte tous les professionnels qui accueillent, écoutent, soignent et orientent les femmes sans considération d’âge, victimes de violences commises par leur conjoint ou ex conjoint, dont le nombre est estimé à environ 220 000 chaque année dans notre pays. Ce refuge, fondé en 2016 par Ghada Hatem, gynécologue obstétricienne à L’hôpital Delafontaine, leur offre gratuitement un accompagnement global, qui va des démarches administratives ou juridiques à leur santé physique et psychologique, priorité des nombreuses personnes qui se relaient ici, bénévoles autant que professionnels, pour aider ces femmes à se reconstruire pas à pas, selon leur volonté et la réalité de leur situation.
Accolée à l’hôpital Delafontaine auquel elle est rattachée à Saint-Denis dans la banlieue nord de Paris, se trouve une maison pleine de couleurs, ouverte à toutes les femmes victimes de violence, quelles que soient leur âge, nationalité ou condition. « Ici, tout leur dit : “parce que vous êtes importantes, nous nous sommes donnés les moyens de bien vous accueillir”. Ce message, induit par l’esthétique et l’architecture du lieu, elles le reçoivent cinq sur cinq », explique en souriant Ghada Hatem, qui a conçu, a levé des fonds privés comme publics pour construire cet espace de soin, puis l’a fait évoluer grâce à toute une équipe depuis 2016. Avec l'Institut Women Safe & Children, créé en 2014 à Saint-Germain-en-Laye et qui a formé certaines de ses professionnelles, il est l'un des rares lieux en France à proposer à ces femmes une telle approche holistique. Chaque jour, elles sont en moyenne 80 à sonner au portail de la Maison des femmes, donnant sur la rue et protégée par un cadre en bois pour leur assurer une discrétion absolue. Elles y sont écoutées, conseillées et bien sûr soignées. Avec trois unités spécifiques de prise en charge : planning familial ; violences conjugales, sexuelles ou intrafamiliales ; femmes victimes de mutilations sexuelles comme l’excision. « Pousser la porte, c’est ce qu’il y a plus dur pour ces femmes en détresse morale, témoigne Sophie, assistante médico-administrative depuis la création du lieu. Il y en a qui s’y prennent à plusieurs fois. On leur dit qu’elles sont des battantes, car il leur faut beaucoup de courage pour raconter l’indicible, la violence qu’elles ont vécues. »
Un guichet unique pour chaque femme victime de violence
L’originalité du lieu, c’est le guichet unique. Quand une femme arrive pour exposer sa situation, immédiatement quelqu’un l’écoute et l’oriente vers un parcours. Ce premier contact est déterminant pour celles qui osent franchir le seuil. Isabelle (à droite sur la photo) n’hésite jamais à quitter son poste d’accueil pour venir leur parler et surtout les rassurer. « L’important, dit-elle, est de tout leur expliquer et de leur laisser le choix, car la plupart du temps, elles n’ont justement jamais eu le choix dans leur vie. Nous tentons d’abord de leur restituer leur autonomie, leur libre arbitre. » Adressées le plus souvent par des professionnels extérieurs, médecins généralistes, urgentistes, assistantes sociales, PMI (Protection Maternelle Infantile) ou encore avocats, les femmes sont reçues avec ou sans rendez-vous. Elles résident majoritairement en Seine-Saint-Denis, mais viennent parfois de départements voisins en Île-de-France, ce qui cause potentiellement un souci pour leur suivi régulier, dès lors que beaucoup d’entre elles n’ont pas les moyens de s’offrir un carnet de ticket de métro chaque semaine.
Juste après l’accueil à l’entrée du lieu, très important, c’est l’heure du premier entretien, tout aussi essentiel. Il se passe en binôme avec, face à la visiteuse, systématiquement une sage femme ainsi qu’une autre professionnelle, le plus souvent psychologue ou assistante sociale. Ce moment, qui suppose un long temps d’écoute, servira de référence pour définir le parcours de la personne, avec selon les cas des consultations auprès d’une psychologue, d’une sexologue, de médecins, de l’assistante sociale qui s’occupe de son suivi bien sûr, mais aussi d’avocats ou d’officiers de police. Toutes se déroulent au sein de la Maison des femmes. La prise en charge est individuelle et holistique, collégiale et inscrite dans la durée.
« C’est crucial pour chaque femme qu’elle n’ait pas à répéter sans arrêt leur histoire, insiste Mathilde (en photo), sage femme coordinatrice de soins. Tous ceux qui vont lui prodiguer des soins doivent connaître son dossier. La violence fatigue, morcelle la personne. À l’inverse, une approche globale, touchant tous les domaines de la vie, la réassemble. » Formées à la « médecine de la violence », prenant en compte tous les soucis qui peuvent s’en suivre (maladies chroniques, diabète, hypertension, dépression, addiction, suicide, etc.), les sages femmes sont les « dépositaires » de la parole de ces femmes. Elles leur permettent de comprendre, de prendre du recul sur ce qui leur arrive. « Nous les écoutons, nous leur montrons que nous les croyons, dit Mathilde, nous les aidons à la fois à déconstruire la stratégie de l’agresseur et à reconnaître les conséquences de cette violence sur leur santé et celle de leurs enfants. Enfin, nous faisons tout pour simplifier leurs démarches. Bref, nous cheminons avec elles. »
« Le trauma vécu par ces femmes, leur précarité, leur isolement, mais aussi le contrôle qu’exerce sur elles leur conjoint, obstacle à leur liberté de mouvement, rendent leur situation encore plus dure. Comment imaginer qu’elles puissent se renseigner, se rendre dans un commissariat, puis dans une unité médico-judiciaire, aller ensuite dans un centre médico-psychologique pour une consultation, trouver une assistante sociale, etc. ? » Arrivée en septembre 2020 en qualité d’assistante sociale, Séverine a travaillé auparavant pour des centres d’hébergement d’urgence. « Dans mes postes précédents, j’ai constaté à quel point il s’avère compliqué, par exemple, de trouver un psychologue quand la consultation n’est pas remboursée par la CMU, alors que l’aide psychologique est essentielle tant pour les femmes demandeuses d’asile que pour les victimes d’un conjoint toxique. Ce problème ne se pose pas dans un espace comme la Maison des femmes, où toutes les compétences sont réunies pour assurer une prise en charge globale. Je mesure l’efficacité de ce parcours de soin dès le deuxième ou troisième entretien avec la personne. Le “Je” prend progressivement plus de place que le “Il” », référence à l’agresseur avec lequel elle vit ou vivait, qui revient sans cesse dans les discussions et dont l’emprise psychologique s’avère si difficile à briser.
Laisser les femmes parler ou non, prendre leurs décisions à leur rythme…
Psychologue à l’unité médico-judiciaire du département de Seine-Saint-Denis, Drenuscha est détachée à la Maison des femmes une demi-journée par semaine, et reçoit chaque mercredi matin. Certaines femmes préfèrent intégrer dans un premier temps un groupe de paroles, plutôt que de consulter un psychologue. « Les femmes que je découvre ici, dit Drenuscha, ont eu un parcours traumatisant, qu’il peut être trop douloureux de verbaliser tout de suite. Je leur laisse donc le temps. Les premiers entretiens peuvent être très courts, mais c’est déjà énorme que la personne ait le courage de venir me voir, ne serait-ce que pour me jauger. Cela démystifie la consultation psychologique, et je sais que le rendez-vous suivant sera plus prolifique. » La Maison des femmes propose pour chacune de 25 à 30 séances gratuites de suivi psychologique. « Les femmes migrantes, par exemple, peuvent-elles vraiment guérir des violences conjugales, sexuelles, intrafamiliales ou même administratives qu’elles ont dû subir ? L’enjeu serait plutôt de trouver comment “faire” avec ce vécu-là, pour qu’il ne “déborde” pas trop, qu’il soit intégré au mieux, dans la mesure du possible. C’est la condition pour parler de “mieux-être” et donner un peu de pouvoir d’agir à ces femmes qui ont toujours été maintenues dans une position victimaire. »
L’un des enjeux majeurs, pour que les victimes retrouvent une capacité d’agir, est de les aider à raconter et ainsi mettre à distance ce qu’elles ont vécu ou parfois vivent encore. C’est notamment le travail de Karine, conseillère conjugale. « Spontanément, explique-t-elle, elles n’arrivent pas à mettre des mots sur leur histoire, à cause des représentations collectives que l’on a du couple, des tabous autour de la sexualité, etc. Aucune culture ne permet plus qu’une autre ce type de prise de parole. Il y a aussi les représentations autour du terme “violence”, sans guère de nuance de la simple violence verbale à la violence physique extrême. Certaines femmes disent de leur mari qu’il n’est pas violent car il ne les frappe que de temps en temps. D’autres, qui ont des relations sexuelles sous consentement contraint, ne le perçoivent pas comme une violence. » Les professionnels de la Maison des femmes les aident à penser à elles-mêmes pour trouver leurs clés de sortie, à comprendre ce qu’elles souhaitent vraiment. « Nous ne devons pas interférer, en essayant d’imposer nos propres représentations de la violence », souligne Karine.
Et la fondatrice du lieu, Ghada Hatem, de rajouter : « Nous pouvons nous trouver face à une femme qui désire qu’on la soigne, mais qui ne veut pas porter plainte. Ce n’est pas à nous de lui imposer. Car si la plainte est sans effet et que le conjoint apprend qu’elle a été déposée, cela pourrait mettre la patiente dans une situation de danger plus grave encore. »
Se réapproprier son histoire, sa personnalité, c’est aussi se réapproprier son corps et sa sexualité. Le Docteur Arnaud Sevene, sexologue praticien à l’hôpital Delafontaine et à la Maison des femmes deux jours par semaine, pose ici devant le portrait de Lucien Neuvwirth, homme politique français qui mena une dure bataille pour le droit des femmes à la contraception. Il aide ses patientes, ayant subi des mutilations sexuelles ou des violences conjugales, à retrouver une sexualité. « Aux femmes qui ont été excisées, explique-t-il, nous proposons une chirurgie réparatrice, mais c’est à elles de décider. Quoi qu’il en soit de leur choix, nous les aidons à se reconstruire une autonomie, en les amenant à réfléchir sur les droits sexuels, leur pouvoir de dire “non” et de désirer elles aussi. Une patiente m’a confié un jour : on m’a excisée, on m’a mariée sans me demander mon avis, mon mari me battait. On ne m’a jamais laissé le choix. Maintenant, c’est moi qui décide. »
Leur donner les moyens de trouver de s’en sortir
Accompagner les femmes, entendre, voir pour constater les blessures. Le Docteur Laetitia Lasne, médecin légiste, est de permanence une demi-journée par semaine. Son travail est d’établir des certificats de blessures anciennes ou récentes, d’excision ou de non excision, pour la constitution d’un dépôt de plainte ou pour l’historique d’un dossier. Aussi délicat que cela puisse paraître, un tel constat de « cicatrices » s’avère souvent indispensable, par exemple pour obtenir l’asile ou sur un autre registre pour demander un divorce. « Le public l’ignore souvent, mais la plus grosse partie de l’activité professionnelle du médecin légiste est la médecine du vivant, dit-elle. Chaque soignant est ici un maillon d’une prise en charge globale, d’une synergie qui accélère le rétablissement des femmes. Dans mon poste principal (à l’unité médico-judicaire de Pontoise Gonesse), je ne revois les victimes que si je suis appelée à témoigner aux Assises. C’est frustrant. Ici, en revanche, nous proposons un vrai suivi sur le long terme. » Laetitia apprécie cette démarche. Malgré l’extrême précarité de beaucoup de ses habitants, elle se sent bien en Seine-Saint-Denis, dont elle est originaire et qui compte 134 nationalités différentes. Elle n’en constate pas moins des violences « que le commun des mortels ne connaîtra jamais, et c’est heureux pour eux », des situations qui exigent des professionnelles « de terribles efforts pour dissocier leur travail et leur vie privée, afin de ne pas se laisser déborder par les émotions. »
L’équipe bénévole de la Maison des femmes compte 12 avocats et 17 juristes qui viennent à tour de rôle. Ce nombre important assure la pérennité des consultations juridiques gratuites, puisque chaque personne n’intervient qu’une matinée par mois et ne prend en charge le tutorat que de deux patientes. Emmanuelle (à gauche au fond), coordinatrice de la permanence juridique depuis juillet 2019, et Kamila, avocate dans un cabinet parisien, apportent leur expertise sur les procédures de divorce, les possibilités d’aménagement pour les enfants en cas de séparation, les droits au travail, etc. Elles sont un appui précieux pour celles qui méconnaissent leurs droits ou pour les assister dans des procédures. « Certains de nos avocats les représentent dans le cadre de l’aide juridictionnelle. D’autres, plus rarement, acceptent de le faire bénévolement », dit Emmanuelle.
Il s’agit de bénévolat, également, pour la policière qui accompagne ces femmes en assurant une permanence toutes les semaines. Elle les informe sur leurs droits, le déroulement des plaintes, et elle les prépare aux questions pouvant les mettre mal à l’aise. Car comment avancer dans sa vie quand on a peur de l’autre ? Julie (de dos) est venue ce matin pour la consultation juridique : « Avant, je me demandais comment j’allais pouvoir expliquer à mes interlocuteurs ce que je vivais à la maison. Je paniquais à l’idée que l’on ne me comprenne pas. J’avais donc abandonné toutes mes démarches… La Maison des femmes m’a sortie de mon isolement, de ma peur. »
L’assistance administrative, dernier né des services du lieu, est proposée deux fois par mois depuis juin 2020, et ne désemplit pas. Laura (à gauche), chef d’entreprise, et Yolaine, responsable communication, dispensent bénévolement leur expertise pétrie « de bons sens et d’internet » à celles qui ont besoin d’aide pour les démarches administratives ou qui entreprennent un retour vers l’emploi. « Nous sommes au cœur de ce que l’on appelle la fracture numérique et administrative, résume Yolaine. Toutes les instances comme la CAAF sont numérisées et les millefeuilles administratifs restent trop importants en France, surtout pour les femmes issues de la migration. » Détail plein de sens : contrairement aux soignants ou assistantes sociales, Yolaine et Laura les aident sans connaître les raisons pour lesquelles les femmes sont là, qu’elles devinent parfois au détour de leurs discussions : « Nous ne devons pas nous substituer aux professionnels médicaux. Nous leur apportons juste notre aisance rédactionnelle et orale. »
Pour mieux prendre soin : de la dermatologie… au karaté
Ancienne chef de pole hospitalier dans un service de dermatologie, à la retraite depuis six mois, le Dr Sigal propose une permanence dermatologique deux fois par mois. Elle connaît mieux que personne la difficulté pour les femmes en grande précarité d’avoir accès aux soins dermatologiques, obligatoirement prescrits par un médecin généraliste. Ici, les femmes la consultent pour faire disparaitre « les cicatrices liés aux abus qu’elles ont subis, ces marques physiques qui, selon elles, les stigmatisent. »
Mais l’ancienne praticienne hospitalière ne fait pas que consulter à la Maison des femmes. Elle a créé un atelier karaté avec Laurence Fischer, triple championne du monde de karaté et fondatrice de l’association Fight for dignity. Les séances hebdomadaires, dédiées à cet art martial, sont même utilisées pour une étude d’évaluation des bienfaits de ce sport dans le parcours de femmes victimes de violence et de son impact sur le stress post-traumatique, en collaboration avec le département Activités physique adaptés de l’université de Strasbourg.
Ce mercredi de décembre 2020, elles sont plusieurs à se rendre au gymnase de l’hôpital Delafontaine pour enfiler un kimono. Dans le cadre de leur parcours, en fonction de leur santé et de leurs affinités, les médecins ou les sages femmes peuvent leur recommander de participer à cet atelier karaté, animé ce jour par Lamya (au centre), intervenante de l’association Fight for dignity. « Ici, nous ne sommes pas dans une pratique de défense contre l’agresseur, explique-t-elle. Notre objectif, c’est de rendre accessible à ces femmes la pratique d’un sport qui les aide à se reconstruire. » Chaque séance dure 1h30. Elles travaillent sur leur respiration, leur posture. Il s’agit de les encourager à se grandir, à relâcher leurs épaules, à garder le regard droit, de leur offrir un socle de résilience pour ne plus se recroqueviller et baisser les yeux dans leur vie quotidienne. « Quand une personne subit des violences, ajoute Lamya, son corps et son esprit peuvent se dissocier. Reconnecter le corps au mental, c’est la porte d’entrée pour se sentir mieux. »
Après la séance, celles qui le souhaitent peuvent partager un goûter où chacune s’exprime. « À la maison, il ya trop de problèmes, confie laconiquement Sarah. Ici, je me sens en sécurité. Je me sens écoutée et respectée. J’attends le mercredi avec impatience. C’est ma fenêtre à moi. » Tandis que Sophia ajoute : « Ici, on m’accepte telle que je suis, cela n’a pas de prix. »
Des ateliers pour se reconstruire
En service civique jusqu’en juin 2021, Sarah anime toutes les semaines un atelier d’apprentissage du français écrit et oral, qui a aussi une fonction de socialisation. Après que ces cours de français aient été refondus en trois niveaux (débutantes, intermédiaires et confirmées), les bénévoles ont constaté une émulation : la naissance d’un « faire ensemble qui les aide à reprendre leur vie en main ». Car « elles ont une vraie soif d’apprendre, témoigne Sarah. Beaucoup ont du interrompre leur scolarité très tôt. Cet atelier est pour elle une bulle d’empowerment, où elles valorisent leurs aptitudes intellectuelles comme jamais elles n’ont pu le faire auparavant. » Sur un cahier, on peut lire, en première phrase de l’exercice : « Je suis Mariama », en Français. Une affirmation moins anodine qu’il n’y paraît, car réussir à écrire « je suis » est une petite victoire pour ces femmes…
Certaines cicatrices, plus psychiques que physiques, supposent de compléter les soins de santé par des activités réparatrices. Pour la fondatrice de la Maison des femmes, Ghada Hatem, la prise en charge la plus efficiente mixte différentes approches. La dimension psycho corporelle, en particulier, lui semble essentielle dans le parcours de reconstruction.
Emmanuelle (au centre de la photo) anime un atelier de danse orientale où les femmes restaurent un dialogue avec leur corps, renouent avec leur féminité par la musique et le mouvement. « Qu’est-ce que tu veux raconter avec ton corps, Samia ? Que tu as confiance en toi ! »… Emmanuelle encourage les danseuses à prendre confiance, à accepter la joie qu’elles ressentent ensemble, se réappropriant leur corps. « Cela aide à ressentir autre chose dans son corps que de la douleur », confie Sophie, qui suit un parcours de reconstruction.
Depuis quatre années, l’illustratrice Clémentine du Pontavice et la photographe Louise Oligny ont développé un atelier multi-supports intitulé « Estime de soi ». Il s’articule autour de la photographie, du dessin et de la création de bijoux. Chaque lundi, les femmes se retrouvent pour fabriquer des bijoux, se faire photographier avec les parures qu’elles ont crées, puis elles utilisent ce portrait photographique pour se regarder et dessiner chacune leur autoportrait. Les deux artistes se sont beaucoup questionnées pour élaborer cet atelier hebdomadaire qui sollicite « le faire » comme méthode de reconstruction de soi. « C’est un temps pour qu’elles puissent s’accepter et se trouver belle », explique Louise.
L’exercice de création, de prise de photo puis de dessin convoque les émotions de ces patientes, dont 80 % sont des mères. Parfois, dans cet atelier, certaines laissent couler des larmes qu’elles restreignent d’habitude, en particulier devant leurs enfants. « Ici, c’est un bon point de départ pour les femmes qui n’ont pas envie de se livrer tout de suite avec un psychologue, analyse Laura (à droite sur la photo), stagiaire en master de psychologie Art-Thérapie. Lorsqu’elles fabriquent ensemble un bijou, les femmes papotent et une brèche s’entrouvre. »
« C’est la deuxième fois que je viens à l’atelier, et c’est le seul endroit où je me sens libre de m’exprimer, confesse de son côté Nedjma. J’ai même le droit de pleurer. À l’extérieur, je me sens opprimée. Ici, je me sens libre. »
L’ambition d’aller plus loin, pour les femmes… et la Maison
L’atelier théâtre hebdomadaire, animé par la franco-libanaise Nadine Naous, réalisatrice de documentaires, concourt lui aussi au mieux-être de ces femmes.
« Avant, je ne parlais pas, se souvient Karine. La psychologue m’a donné des dizaines de rendez-vous, je n’ouvrais pas la bouche. Le théâtre m’a sauvé. J’ai pu crier, faire sortir toute la violence que j’ai subie. Je ne prends plus de traitement pour dormir et je me sens maintenant comme une adolescente. J’ai à nouveau confiance en la vie. »
Réunies dans la salle de réunion de la Maison des femmes, elles improvisent des saynètes, souvent inspirées de leur histoire sans même qu’elles l’aient anticipé. Redonner vie à leur passé, même le plus traumatisant, permet de le mettre à distance. Certaines ont plus de difficultés à mettre en scène leur vécu, mais entendre les histoires des autres permet de mieux accepter la sienne. Le collectif brise l’isolement.
De l’atelier thérapeutique à la vraie scène théâtrale, trois participantes ont franchi le pas. Grâce à la force collective de cet atelier théâtre, elles sont montées sur les planches du Théâtre de la Tempête en janvier 2020, aux cotés de deux comédiennes professionnelles, dans une adaptation libre des Métamorphoses d’Ovide.
« Vivre quelques années dans le chaos d’une guerre civile m’a fait prendre consciente très tôt qu’il était vital de prendre en charge les problèmes humains », raconte Ghada Hatem, elle aussi franco-libanaise, arrivée en France à 18 ans. Inlassablement, cette femme médecin se bat pour assurer la pérennité de la Maison des femmes, les professionnels à plein temps (à la différence de ceux qui sont détachés par leur structure une ou plusieurs demi-journées) étant financés par des fondations privées, le plus souvent pour un temps donné. « Nous nous mobilisons, continue-t-elle, pour faire reconnaître cette prise en charge globale des femmes victimes de violence, au titre de la santé publique et de la prévention, mais aussi pour que d’autres structures du même genre voient le jour. »
Grace à l’engagement de soignants et de personnalités publiques, de nouveaux projets vont éclore : une maison des Femmes s’ouvrira à Marseille. Un projet d’ouvrir une maison identique à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière se profile aussi à l’horizon, notamment grâce à Tiphaine (à gauche sur la photo), jeune médecin qui consulte deux jours par semaine à la Maison des femmes pour se former au management d’un tel établissement.
Les équipes du lieu interviennent aussi en milieu scolaire, dans un programme intitulé « Des gynécologues à la rencontre des adolescents », pour écouter et dialoguer avec les collégiens et les lycéens sur les rapports hommes femmes, les droits des femmes et les inégalités et discriminations auxquelles elles font face. « Nous croyons beaucoup à cette action, dit la fondatrice de la Maison, car c’est par l’éducation que nous allons faire avancer, même très modestement, l’humanité vers le respect de tous… et toutes. »
Données en plus
En France, le nombre de femmes âgées de 18 à 75 ans qui, au cours d’une année, sont victimes de violences physiques ou sexuelles commises par leur conjoint ou ex conjoint est estimé à 220 000 chaque année. 40 % des cas de violences conjugales débutent dès la première grossesse. Parmi ces femmes victimes, 18% déclarent avoir déposé plainte. Une femme décède tous les trois jours sous les coups de son ex conjoint ou compagnon. Entre 2018 et 2019, le nombre de « féminicides » a augmenté de 21%.
Établissement privé à but non lucratif, la Maison des femmes a ouvert en 2016. Elle accueille chaque jour une moyenne de 80 femmes victimes de violence, dont 42% sont âgées de 25 à 34 ans. Le travail des psychologues représente 27% de l'activité de la Maison, celui des médecins 29%, des sages femmes 18%, et des assistantes sociales 6%.
Son budget annuel est de 1 046 540 euros, dont 629 801 de subventions publiques (Département, Région, Ministère de la Santé..) et 411 561 de dons privés, venant pour la plupart de fondations (Fondation Kering, Fondation de France , Fondation des Femmes, Fondation ELLE, etc.).